Depuis plusieurs jours, une passe d’armes d’un genre inattendu secoue le monde du jeu vidéo. D’un côté, Ross Scott, créateur du mouvement « Stop Killing Games » (SKG), milite pour une réforme en profondeur de la politique de conservation des jeux numériques. De l’autre, Jason « Thor » Hall, fondateur du studio indépendant Pirate Software, s’oppose vigoureusement à ce qu’il considère comme une dérive réglementaire aux conséquences potentiellement désastreuses pour les petits développeurs.
Ce débat, philosophique et politique, nous fait poser une question essentielle : un jeu acheté doit-il rester jouable à vie, indépendamment de la volonté de son éditeur ?
Un mouvement né d’un ras-le-bol consommateur
Le point de départ de l’initiative Stop Killing Games remonte à la fin de l’année 2023, lorsque Ubisoft annonce la fermeture définitive des serveurs du jeu The Crew pour le 1er Avril 2024. Or, bien que jouable en solo, le titre exigeait une connexion permanente. Pour faire simple : une fois les serveurs coupés, le jeu est devenu injouable, même pour ceux qui l’avaient acheté légalement.
Ross Scott, vidéaste et militant, y voit là un abus manifeste du modèle numérique. Il lance alors une Initiative Citoyenne Européenne, un outil démocratique permettant de proposer une législation à la Commission européenne. Sa demande est simple en apparence : imposer aux éditeurs de garantir un accès aux jeux, même après leur retrait des serveurs.
Une proposition qui divise profondément
Le mouvement SKG ou #stopkillinggames a rapidement attiré l’attention. Mais il n’a pas fait l’unanimité. Jason Hall, développeur indépendant à la tête de Pirate Software, s’est publiquement opposé aux revendications du collectif. il accuse SKG de vouloir imposer un fardeau technique et financier inadapté à la réalité des studios modestes.
Selon lui, contraindre les développeurs à maintenir des serveurs ou à livrer des versions hors-ligne est une utopie technocratique. Il dénonce également une vision réductrice du jeu vidéo, réduit à un produit statique, alors qu’il s’agit souvent d’un service évolutif, vivant, par définition temporaire.
Un affrontement direct et médiatisé
Ross Scott ne tarde pas à répondre. Dans une vidéo publiée le 23 juin, il accuse Thor de diffuser de fausses informations et de décrédibiliser la cause des joueurs. Il soutient que SKG ne cherche pas à imposer le maintien éternel des serveurs, mais à garantir une solution de secours , un patch hors-ligne ou une publication du code source , lorsque l’éditeur décide de cesser le support.
La querelle prend rapidement une tournure personnelle. Jason Hall affirme que les propositions de SKG, si elles devenaient loi, menaceraient directement la survie des studios indépendants.
Deux visions irréconciliables du jeu vidéo
Au-delà du conflit de personnes, c’est bien deux conceptions antagonistes du jeu vidéo qui s’affrontent.
- Pour SKG, un jeu vendu doit rester accessible. À défaut, il s’agit d’un mensonge commercial et d’une mise au rebut culturelle. Le collectif considère le jeu comme un bien patrimonial, à préserver comme un livre ou un film.
- Pour Pirate Software, le jeu vidéo « surtout en ligne » est un service vivant. Sa durée de vie dépend de son écosystème. Forcer sa pérennité reviendrait à figer une œuvre incomplète ou à ruiner des studios qui ne peuvent en assumer le coût.
Cette opposition ouvre un grand débat, le grand débat sur la propriété numérique.
L’ombre grandissante du droit européen
En initiant une démarche citoyenne auprès de la Commission européenne, SKG s’est engagé sur le terrain juridique. Pour être étudiée, l’initiative doit réunir un million de signatures dans l’ensemble des États membres de l’Union.
À la date du 3 juillet, plus de 900 000 signatures avaient été enregistrées. La perspective d’atteindre le seuil requis d’ici la fin du mois semble désormais plausible. Si tel est le cas, la Commission devra statuer sur l’opportunité d’une législation obligeant les éditeurs à garantir un mode de jeu jouable après l’arrêt de tout service en ligne.
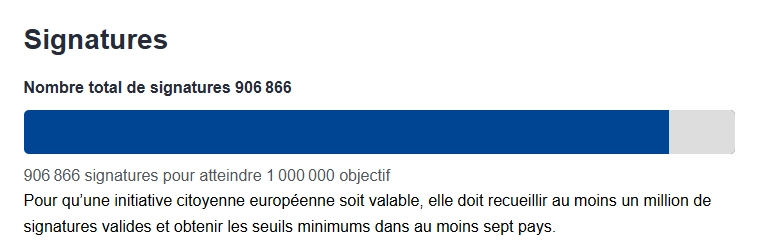
Les éditeurs face au dilemme
Certains grands acteurs du secteur, à l’instar d’Ubisoft, ont partiellement revu leur position. L’éditeur français s’est engagé à proposer des versions hors ligne de The Crew 2 et The Crew Motorfest, sans pour autant revenir sur la suppression du premier opus.
Chez les développeurs indépendants, en revanche, la crainte est réelle. Beaucoup estiment que les exigences techniques de SKG sont incompatibles avec leurs ressources. La publication du code source, souvent bâti sans anticipation de réutilisation, pose également des questions de sécurité et de propriété intellectuelle.
Et maintenant ?
La question posée par SKG est lourde de conséquences. Si la Commission européenne choisit de légiférer, c’est toute la chaîne de création vidéoludique qui pourrait être impactée : modes de distribution, modèles économiques, responsabilités post-commercialisation.
À l’inverse, un échec de l’initiative pourrait entériner l’idée que le jeu vidéo, même acheté, reste soumis à une forme d’obsolescence programmée. En l’absence de cadre juridique clair, la pérennité des œuvres restera dépendante du bon vouloir des éditeurs ou des efforts bénévoles de la communauté.
Le jeu vidéo, un bien culturel à part entière ?
Derrière ce débat se cache une interrogation plus vaste : le jeu vidéo mérite-t-il les mêmes égards que les autres arts ? Livres, films, musiques bénéficient tous de dispositifs de conservation, de bibliothèques publiques, de dépôts légaux. Le jeu vidéo, pourtant devenu premier marché culturel au monde, demeure encore traité comme un produit de consommation courante.
L’issue de cette bataille entre Stop Killing Games et Pirate Software ne tranchera peut-être pas définitivement cette question. Mais elle marque un tournant. Le jeu vidéo grandit et entre dans l’ère de la maturité politique.
Le lien de la Pétition Stop Killing Games

